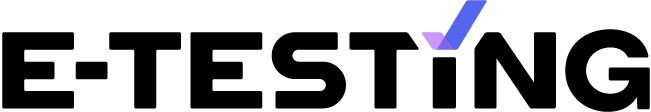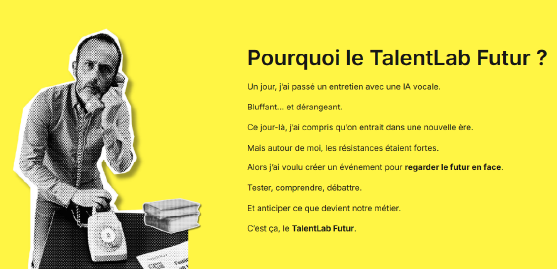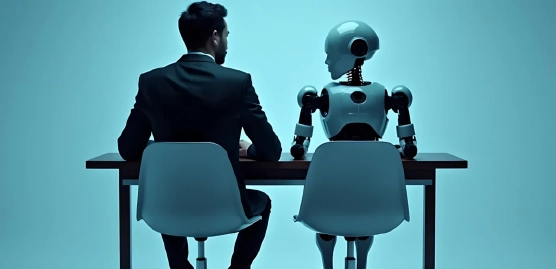Faut-il en déduire que les compétences techniques ne suffisent plus à garantir l’employabilité ? C’est sans doute vrai ! La capacité à s’adapter, à apprendre en continu et à évoluer dans des environnements complexes, devient essentielle.
Mais que recouvrent réellement les compétences du futur ? Comment distinguer une tendance passagère d’un changement de fond ? Et surtout, comment les anticiper, les évaluer et les développer, que l’on soit salarié, recruteur ou dirigeant ?
Qu’appelle-t-on compétences du futur ?
La notion même de compétence a changé. Il ne s’agit plus seulement de savoir-faire. Ce qui compte, c’est la capacité à bouger avec son environnement, même s’il est imprévisible.
Les compétences du futur désignent ainsi l’ensemble des aptitudes, techniques, humaines et cognitives, qui permettent de rester pertinent et opérationnel, peu importe le contexte.
Vers une accélération inédite de l’obsolescence des savoirs
Selon le Baromètre mondial des emplois liés à l’IA publié par PwC en juin 2025, les savoir-faire évoluent 66 % plus vite dans les métiers les plus exposés à l’IA, contre 25 % seulement un an plus tôt.
Dans certains secteurs comme la tech ou le marketing digital, certaines compétences deviennent obsolètes en quelques mois à peine.
Les entreprises ne peuvent plus raisonner avec des grilles de compétences figées. Ce qu’il faut rechercher et encourager, ce sont des profils capables d’apprendre, de s’adapter et de recommencer. Cela passe par :
- le développement des soft skills (créativité, pensée critique, flexibilité)
- des formats de formation plus souples
- et un suivi régulier de l’évolution des référentiels de compétences
Cette réalité touche néanmoins tous les métiers et tous les niveaux d’expérience.
Les trois grands types de compétences à articuler
Les compétences du futur ne s’organisent plus selon une hiérarchie rigide. Elles se répartissent plutôt en trois registres qu’il faut apprendre à articuler.
- Les compétences techniques évoluent au rythme des outils, des métiers et des enjeux de société : automatisation, cybersécurité, IA, transition énergétique, etc. Elles restent le socle d’une expertise à un instant donné, mais leur durée de vie s’amenuise.
- Les compétences humaines, souvent regroupées sous le terme de soft skills, renvoient à la capacité à interagir, comprendre, convaincre, coopérer. Intelligence émotionnelle, pensée critique, communication claire, sens du collectif : ce sont elles qui soutiennent la dynamique d’équipe et la prise de décision dans l’incertitude.
- Les compétences d’adaptation englobent l’aptitude à apprendre, désapprendre, gérer le changement, évoluer en autonomie. On y trouve l’agilité intellectuelle, l’auto-organisation, la curiosité ou encore la capacité à prendre du recul. Ces compétences ne sont pas toujours visibles, mais elles conditionnent la trajectoire professionnelle sur le long terme.
Ces catégories ne sont pas hermétiques. Elles tendent plutôt à s’hybrider :
- un développeur doit savoir expliquer son travail à un public non technique,
- un manager doit comprendre les enjeux technologiques,
- un chef de projet doit maîtriser l’art de s’exprimer à l’oral tout autant que celui des outils.
Une nouvelle définition de la compétence : apprendre à apprendre
Quand les métiers évoluent plus vite que les formations initiales, seule la capacité à apprendre, désapprendre et réapprendre permet de rester dans la course.
Apprendre à apprendre constitue donc bien plus qu’une aptitude : c’est une « méta-compétence », qui mêle savoirs, attitudes et stratégies d’adaptation.
C’est aussi dans cet esprit que le législateur a instauré la notion de formation tout au long de la vie (art. L6111-1 du Code du travail), et soutenue par divers dispositifs comme le CPF.
Quelles transformations redessinent les compétences du futur ?
Au-delà de l’intelligence artificielle, les compétences du futur reflètent des transformations plus vastes. Celles-ci touchent aussi bien nos outils que nos valeurs, nos modes de vie que nos façons de travailler ensemble.
L’impact des technologies et de l’automatisation

L’automatisation ne fait pas que remplacer certaines tâches : elle redéfinit les contours de certains métiers.
Cela ne signifie pas non plus la disparition massive de l’emploi. Ce qu’on attend désormais, ce ne sont pas des experts d’un outil figé, mais des profils capables de :
- apprendre
- comprendre les usages des technologies
- collaborer efficacement avec elles
Les compétences métiers deviennent plus facilement périssables, tandis que l’adaptabilité, la résolution de problèmes complexes ou encore la pensée critique viennent prendre le relais.
La transition écologique, moteur de nouveaux métiers
La transition écologique est aussi une transformation du travail. De nombreux secteurs sont concernés : construction, industrie, logistique, énergie, agriculture, finance.
Ce changement crée alors de nouveaux besoins :
- comprendre les impacts environnementaux de son activité
- intégrer des critères RSE dans les décisions
- anticiper les régulations futures.
Selon l’ADEME, la transition écologique pourrait générer jusqu’à 900 000 emplois en France d’ici 2050. Concrètement, cela se traduit par une forte demande de compétences dans l’efficacité énergétique, la gestion des ressources ou encore l’écoconception.
Mais ces compétences dites “vertes” ne concernent pas uniquement des métiers techniques. Elles supposent aussi un changement de posture tel que la capacité à remettre en question ses pratiques et coopérer dans un objectif commun de durabilité.
L’évolution des attentes sociétales
Les évolutions sociétales bousculent les attendus professionnels. Les jeunes actifs sont, par exemple, plus sensibles aux enjeux de sens, d’inclusion et d’impact social. En parallèle, les entreprises sont attendues sur leur capacité à créer des environnements inclusifs, responsables et équilibrés.
Dans ce contexte, certaines compétences deviennent incontournables : intelligence émotionnelle, communication interculturelle, capacité à travailler avec des profils divers…
Les nouvelles formes d’organisation du travail
Télétravail, flexibilité, équipes éclatées, management horizontal… La manière de travailler a radicalement changé depuis la crise sanitaire. Pour autant, cette transformation ne s’accompagne pas automatiquement des compétences adéquates.
Aujourd’hui, il ne suffit plus de savoir exécuter une tâche. Il faut aussi être capable de s’auto-organiser, de prioriser, de communiquer à distance de façon claire, et de prendre des décisions sans attendre une validation hiérarchique à chaque étape.

Anticiper, évaluer et développer les compétences du futur : 4 étapes à suivre
Identifier les compétences clés ne suffit plus. Ce qui distingue aujourd’hui les organisations les plus résilientes, c’est leur capacité à structurer une démarche proactive et continue de gestion des compétences.
#1 - Cartographier les compétences de manière dynamique
La première étape consiste à disposer d’une vision claire des compétences disponibles dans l’organisation. Mais cette photographie n’a de valeur que si elle est actualisée régulièrement et articulée à des besoins projetés, non uniquement présents.
Plutôt que de se limiter à un inventaire statique, il est préférable d’opter pour des cartographies évolutives, qui croisent :
- les référentiels métiers internes
- les tendances sectorielles
- les objectifs stratégiques à moyen terme
Cette approche permet d’identifier les écarts de compétences (Skill Gaps) et de les traiter de manière ciblée.
#2 - Évaluer autrement : au-delà des diplômes et de l’expérience
Pour mesurer le potentiel réel d’un individu, il est indispensable de sortir des critères classiques (CV, ancienneté, formation initiale).
Ce que les entreprises cherchent à détecter aujourd’hui, ce sont des indicateurs d’agilité et de développement futur :
- la capacité à raisonner dans des contextes nouveaux
- l’adaptabilité
- les aptitudes à apprendre, coopérer et se remettre en question
Les tests jouent un rôle déterminant. Évaluer à la fois les compétences techniques via des tests hard skills et les aptitudes comportementales via des tests de soft skills permet de mieux cerner le potentiel réel d’un candidat. Ces outils apportent un regard objectif, moins soumis aux biais classiques de sélection. Ils s’intègrent aussi bien dans un processus de recrutement que dans une logique de mobilité ou de développement interne.
Randstad utilise E-testing pour sécuriser ses recrutements à grande échelle
Face à des volumes de candidatures massifs, Randstad s’appuie sur la plateforme E-testing depuis plus de 10 ans. Tous les candidats, du manutentionnaire à l’ingénieur, passent systématiquement des tests métiers mais également des tests de sécurité. Intégrée aux outils internes, la solution permet un gain de temps, ainsi qu’une meilleure adéquation des profils.
« Notre politique est d’ailleurs claire : 100 % de nos candidats, quel que soit le poste visé, du manutentionnaire à l’ingénieur, doivent passer des tests E-testing. »
Samir Bendjilali, Responsable du Centre d’Expertise Transport & logistique, Randstad
#3 — Former de manière ciblée et continue
Le développement des compétences du futur ne peut plus reposer uniquement sur des formations ponctuelles ou descendantes. Il s’agit désormais de créer des parcours modulables, centrés sur :
- des situations concrètes de travail (projets, missions transverses, mobilité interne)
- des formats courts et activables à la demande (microlearning, coaching flash, mentorat)
- des outils numériques capables de recommander des contenus en fonction des profils et des trajectoires.
Ce ne sont plus les “heures de formation” qui comptent, mais la capacité à activer la bonne ressource au bon moment, dans un contexte donné.
#4 — impliquer les managers et les RH dans une logique de co-construction
Dernier levier, et non des moindres : la posture des RH et des managers. Face aux transformations en cours, ils ne peuvent plus rester dans une logique purement descendante.
Il devient essentiel de :
- impliquer les collaborateurs dans l’identification de leurs besoins
- rendre visible la montée en compétences au fil du temps
- instaurer un dialogue régulier sur les trajectoires professionnelles
C’est cette culture de l’ajustement continu qui permet de transformer la gestion des compétences en véritable changement.
Ce ne sont plus les diplômes ou les savoirs figés qui font la différence, mais la capacité à évoluer avec son environnement.
Apprendre, se remettre en question, s’adapter : c’est ce que demandent aujourd’hui les entreprises, et ce que recherchent de plus en plus de collaborateurs.
Le vrai enjeu n’est donc plus d’avoir les bonnes compétences aujourd’hui, mais d’être prêt à les faire évoluer demain.